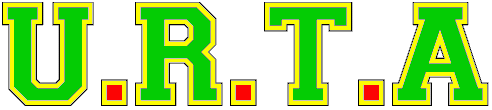| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 1800 |
|
Au début du 19ème siècle,
le commerce mercantile et une domination étrangère
rampante prennent lentement le relais de la traite des esclaves
au Togo. Vers le milieu du 19ème arrivent les premiers
missionnaires allemands, suivis quelques décennies plus
tard par des maisons de commerce allemandes. Ces derniers renforceront
leur présence sur la côte maritime à travers
des comptoirs et factoreries. |
| |
|
|
| 1884 |
|
Sur la base d'un Accord à la formulation floue signée
le 05.07.1884 entre le Consul impérial allemand, Dr.
Gustav NACHTIGAL et le Chef traditionnel d'une région
côtière, le roi MLAPA III de Togoville,
le territoire est désigné pour la première
fois comme "un protectorat de l'Empire allemand"
(deutsches Reichsschutzgebiet), euphémisme pour désigner
ce qui deviendra pratiquement en l'espace de quelques années
une colonie.
Ce traité de protectorat ressemblait beaucoup plutôt
à un accord commercial, dans lequel "la communauté
de vue des parties signataires (Übereinstimmung)"
était mis en exergue et supposé sans effet pour
la souveraineté politique. La possibilité d'une
intervention militaire de l'Empire allemand était pourtant
évoquée de façon accessoire "en
cas de menaces pour les intérêts commerciaux"
(..., daß bei Gefährdung für den Handel, das
Deutsche Reich Schutz gewähren würde").
Des expéditions militaires allaient permettre d'étendre
la superficie du Togoland de 40.000 km2 à quelques
87.000 km2 par une population de 0.7. Mio. d'habitants en
1884. (Population en 2002: env. 5,0 Mio. sur 56.000 km2).
L'expansion et la mise en exploitation de l'espace d'application
de ce traité de protectorat se heurtent à des
résistances dans diverses régions du territoire,
provoquant des actes de sabotages réprimés avec
brutalité.
|
| |
|
|
| 1895 |
|
Des rebellions à répétition
des populations du Togo contre le nouvel ordre colonial sont
réprimées brutalement et souvent le sang. Ces
répressions entraînent l'exode d'un pourcentage
non chiffré des populations togolaises à vers
la Gold Coast sous domination britannique ou le Dahomey sous
domination française. |
| |
|
|
| 1897 |
|
Après Bagida et Zébé
(Sebe ou Sebewi en Allemand) la ville portuaire de Lomé
devient le siège de l'administration coloniale allemande
et pratiquement la capitale du Togo.
Lomé fut fondée quelques siècles plus
tôt par un chasseur du nom de Djitri (Dzitri
en langue éwé) qui avait bâti sa paillote
de chasse dans les plantations de cure-dents, Alomé.
Il serait venu de l'Est et y aurait fondé la première
colonie d'habitation à Bè, aujourd'hui un quartier
de Lomé.
|
| |
|
|
| 1914 |
|
Au début de la première guerre mondiale,
les troupes alliées franco-britanniques venues du Dahomey
(aujourd'hui: Bénin) et de la Gold Coast (aujourd'hui:
Ghana) mettent fin à l'ère coloniale allemande
et occuperont le territoire du Togoland. |
| |
|
|
| 1919 |
|
Comme conséquence immédiate des
demandes en réparation des Alliés franco-britanniques
vis-à-vis de l'Allemagne, les colonies allemandes sont
confisquées et le Togo tombe sous cette clause. Sur la
base du Traité de Versailles, deux
tiers du Togo (2/3) passe sous administration française,
un tiers (1/3) sous administration britannique comme zones d'occupation. |
| |
|
|
| 1922 |
|
La Société des Nations
(SDN) reconnait les mandats administratifs de la France et du
Royaume Uni sur les zones d'occupation respectives et mandate
en même temps les puissances occupatrices de préparer
leurs territoires respectifs à l'émancipation
en vue de leur autodétermination.
Quand bien même juridiquement, le Togo était "Territoire
sous tutelle" au terme du droit international, la réalité
quotidienne n'était nullement différente de l'ordre
colonial qui règnait dans les territoires coloniaux voisins. |
| |
|
|
| 1926 |
|
Les revendeuses des marchés protestent
contre la loi sur l'imposition décrétée
par l'administration de tutelle. Ces protestations s'étendent
au refus de la partition du pays et comme expression du rejet
de l'ordre colonial français. Des courants politiques
nationalistes se précisent et forment des structures
dans la clandestinité.
L'administration française réprime les courants
nationalistes par la brutalité et par une législation
taillée sur mesure et en même encourage la formation
de contre organisation présentées comme étant
"progressistes".
|
| |
|
|
| 1946 |
|
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Togo
est placée comme "entité" sous mandat
des Nations Unies. Suite à des mouvements de protestation
et soulèvements à répétition contre
l'ordre colonial au Togo, les Nations Unies rappellent aux puissances
mandataires, en l'occurrence la France et la Grande Bretagne,
leur obligation de se préparer à organiser des
référendums devant donner aux Togolais la possibilité
de se prononcer sur leur autodétermination. |
| |
|
|
| 1956 |
|
Le retard de la mise en oeuvre des résolutions des
Nations Unies sur l'autodétermination amène
les partis politiques et organisations de femmes à
descendre dans la rue.
Quelques mois auparavant, la Loi-cadre du 23.06.1956 accordait
aux territoires français d'outre-mer le statut d'autonomie.
Sur la base de cette loi et sans que des élections
aient été organisées, une Assemblée
territoriale sera nommée au Togo, qui était
pourtant un Territoire sous mandat onusien.
De façon analogue, un gouvernement territorial est
nommé sous la direction de M. Nicolas GRUNITZKY.
MM. Robert AJAVON et Antoine MEATCHI sont nommés
respectivement Président et Vice-Président de
l'Assemblée territoriale, par la volonté de
la France.
L'Assemblée territoriale arbitrairement nommée
par la France est composée à moitié de
Togolais du Nord, à moitié de Togolais du Sud.
Dans cette constellation, les débats politiques au
Parlement avaient vite fait de se polariser en débats
politiques à dominance ethniques.
Autant la répression contre les partisans d'une indépendance
fortes dans la partie du Togo sous tutelle française,
autant dans la partie du Togo sous administration britannique
(Transvolta Region ou Britisch Togoland) un référendum
de 1956 promettait une indépendance à portée
de main selon un calendrier accepté de tous.
|
| |
|
|
| 1957 |
|
Un référendum organisé dans
la Transvolta Region par l'administration coloniale britannique
décide d'incorporer cette partie du Togo dans la Gold
Coast (aujourd'hui: Ghana). Le résultat de ce référendum
a pour conséquence immédiate de redoubler la détermination
des partisans de l'indépendance dans la partie du Togo
sous tutelle française. Il en résultera une lutte
pour l'indépendance menée avec tous les moyens
à bords, afin de sauver ce qui pouvait l'être encore.
La confrontation politique entre partisans de l'indépendance
(nationalistes) et les cercles profrançais (progressistes)
se radicalisent. Cette radicalisation imprimera à la
lutte pour l'indépendance un caractère de "show
down pour tout ou rien". Ces circonstances qui ont
finalement accompagné le référendum d'autodétermination
au Togo sous tutelle française seront d'ailleurs partiellement
à l'origine de certaines tensions entre les gouvernements
dans les années qui suivront immédiatement l'indépendance
du Togo et du Ghana.
|
| |
|
|
| 1958 |
|
Le référendum d'autodétermination
permet la manifestation de la volonté d'une majorité
écrasante de Togolais pour une indépendance de
la France. Après la victoire des Nationalistes sous direction
de Augustino de SOUZA et Sylvanus Epiphanio OLYMPIO,
ce dernier est investi par la première Assemblée
Nationale de la formation du premier gouvernement togolais. |
| |
|
|
| 27. 04.60 |
|
Le Togo accède à la souveraineté
nationale et devient un pays membres du block des pays non-alignés,
doté d'un Constitution pluraliste votée en 1958
et renonçant à se doter d'une armée. Sylvanus
Epiphanio OLYMPIO est élu Président de la
République. Son Vice-président est Antoine
MEATCHI. |
| |
|
|
 |
|
A la gloire du Peuple togolais:
Peuple togolais!
Par ta foi, ton courage et ton sacrifice
La Nation togolaise est née.
|
| Monument de
l'indépendance du Togo (voir épigraphe à
dr.) |
|
|